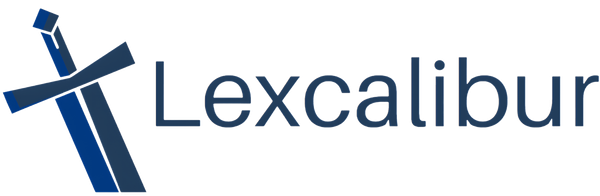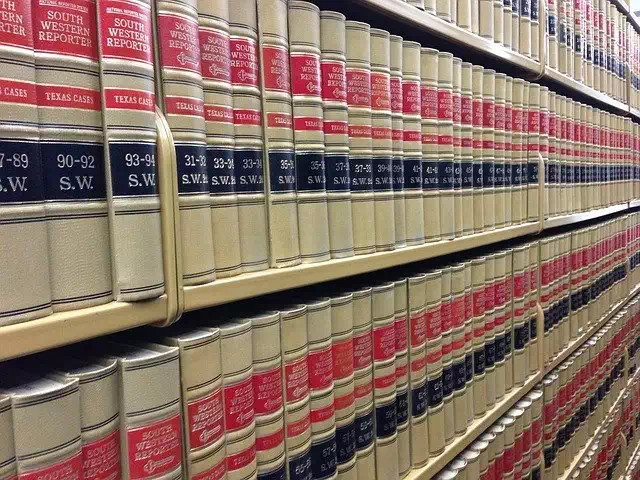Vous n’êtes pas obligé de travailler pour une entreprise, même si vous devrez créer votre propre entreprise individuelle ou votre société unipersonnelle. Toutefois, il sera important d’être attentif au respect de certaines règles contraignantes si vous ne disposez pas du barreau dans la mesure où cette pratique est strictement réglementée, comme nous le détaillons dans ce guide dédié aux contours légaux de la profession de juriste en indépendant.
Les avantages à être indépendant sont nombreux et attractifs, tels que fixer sa propre rémunération, son propre temps de travail ainsi que de choisir soi-même ses clients. Si vous arrivez à trouver votre clientèle, vous pourrez même rapidement gagner plus d’argent qu’en travaillant en entreprise.
1 - À qui s’adresse le métier de juriste indépendant ?
Un prestataire juridique libéral ne détenant pas le barreau doit idéalement être titulaire d’un Master 1 ou d’un Master 2 en Droit, même s’il reste possible d’exercer à partir d’un diplôme de Licence en faculté de Droit. Le domaine de Droit lui-même importe pour ainsi dire peu tant que le juriste arrivera à trouver son marché (voir la section ci-dessous). Cette clientèle peut être composée de particuliers, d’entreprises ou de cabinets d’avocats souhaitant bénéficier d’une aide extérieure sur leurs dossiers. Cette diversité rend le métier de juriste indépendant adapté à toutes les spécialités !
Une profession libérale convient à un certain type de personnalité, autonome et indépendante. C’est une aventure qui met à l’épreuve sur de nombreux aspects, et suppose une aisance orale et une disponibilité à toute épreuve, ainsi que de la persévérance et de la réactivité pour gagner la confiance de vos clients. Un sens de la confidentialité et de l’écoute sont également des atouts indispensables pour assurer un niveau de service de qualité.
Si vous souhaitez directement conseiller vos clients ou les représenter, vous devrez obligatoirement passer une année en Institut d’Etudes Judiciaires (IEJ) afin de se présenter à l’examen d’entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA). Après avoir été admis à cet examen, vous devrez effectuer une période de formation de 18 mois au sein d'une des écoles d'avocats dans le but d’obtenir le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA). A défaut, vous devrez restreindre votre activité aux missions légalement admises, que nous détaillons ici.
2 - Comment trouver votre clientèle ?
Si les missions du juriste exerçant en libéral ne peuvent ni comprendre du conseil juridique, ni une représentation du client, elles n’en restent pas moins nombreuses et potentiellement très lucratives si le juriste arrive à trouver son marché. Pour ce faire, vous devrez avoir une idée précise de la cible que vous cherchez à adresser, afin d’adapter votre profil en fonction. Vous devrez également analyser l'offre et la demande, vous renseigner sur les tarifs appliqués par les autres juristes, etc.

Chez Lexcalibur, nous aidons les prestataires juridiques indépendants à rencontrer leur clientèle. Nous existons donc pour accompagner les juristes indépendants dans leur marketing, en proposant les profils adéquats aux utilisateurs en fonction de leurs missions. Vous pourrez également mettre votre profil en avant sur les moteurs de recherche et sur notre Blog en rédigeant des articles d’actualités, des fiches pratiques, des brèves juridiques ou même en réalisant des interviews. Produisez du contenu de qualité, nous nous chargerons de le présenter au monde !
3 - Quelle structure juridique créer pour commencer à exercer ?
La réglementation française propose un vaste choix de formes d’entreprise, avec chacune leur qualité et leur défaut. Vous devez donc choisir laquelle vous convient le mieux en fonction de votre situation, de votre temps de travail et de vos perspectives. Même s’il est tout à fait possible de modifier son statut social en cours d’exercice, la question n’est pas à prendre à la légère ! Schématiquement, vous pourrez exercer soit en votre nom propre (Entreprise Individuelle), soit par l’intermédiaire d’une société unipersonnelle (EURL ou SASU).
A - L’exercice d’une activité en son nom propre : l’entreprise individuelle
Le nouveau régime unifié de l’entreprise individuelle (EI)
Le principal avantage de l’EI est qu’elle est facile d’accès et rapide à créer. De plus, à compter du 15 mai 2022, toutes les EI bénéficient de la protection du patrimoine du dirigeant, ce qui rend cette forme juridique très intéressante. En effet la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante unifie le statut de l’entrepreneur individuel en supprimant le statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), en raison de sa très faible popularité.
Les avantages :
Le statut juridique de l’entreprise individuelle permet de créer rapidement et simplement votre société sans apport de capital. Aucun capital de départ minimum n’est exigé, et les obligations comptables sont simplifiées : seuls le livre journal, le grand livre et le livre d’inventaire doivent être tenus à jour. Ce régime offre également la possibilité de choisir le régime fiscal de la micro-entreprise (détaillé ci-dessous).
Les inconvénients :
Le principal défaut de ce statut est l’impossibilité de s’associer sans changer de forme sociale. L’absence de personnalité morale propre entraîne également des conséquences : la responsabilité de la société est depuis la loi du 14 février 2022 limitée au patrimoine affecté (sur option), mais la responsabilité financière du dirigeant reste illimitée. Aussi, l'entrepreneur individuel devra forcément être affilié au régime de la Sécurité Sociale des Indépendants, moins protecteur que le régime général.
Conclusion :
L’EI est la forme de société la plus simple autant pour sa création que pour son fonctionnement, mais elle est limitée dans son évolution.
L’option du régime de la micro entreprise
Ce que l’on appelle la micro-entreprise correspond en réalité au « régime micro-entreprise ». Décliné en 3 sous-régimes en fonction de la nature de l’activité (micro-BNC, micro-BIC et micro-BA), il constitue une option laissée à l’entrepreneur individuel. Depuis 2016, le terme auto-entrepreneur a disparu au profit de l’unique appellation micro- entrepreneur, mais il est resté dans le langage courant.
Les avantages :
C’est aujourd'hui un régime unique et simplifié résultant de la fusion des régimes micro-social et micro-fiscal. Il permet de bénéficier de formalités simplifiées pour la création de votre activité, mais aussi pour vos obligations de déclarations et de paiement. En effet vous n’aurez aucune obligation comptable mais uniquement des déclarations de chiffre d'affaires à faire, les montants pris en compte pour les impôts étant ceux encaissés et non ceux facturés.
Les inconvénients :
En contrepartie votre chiffre d'affaires sera plafonné à 72 500 euros. De plus le régime fiscal “micro” appliqué peut parfois être moins intéressant que le régime “classique”.
Conclusion :
Le régime de la micro entreprise est particulièrement limité dans son évolution mais reste “ultra simplifié”, ce qui le rend particulièrement attractif. Il convient de noter qu’il représente 64 % des créations d'entreprises françaises entre 2015 et 2019, selon l'INSEE.
B - L’exercice d’une activité par l’intermédiaire d’une société unipersonnelle
Créer une entreprise unipersonnelle : l’EURL
L’EURL est une forme de société particulière : c’est une société à responsabilité limitée (SARL) composée d’un seul associé. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est ainsi également dénommée « SARL unipersonnelle ». Ce type d’entreprise donne à l’entrepreneur la possibilité de créer une société sans obligation de collaborer avec des associés.
Les avantages :
Ce statut juridique apporte des avantages intéressants : un patrimoine personnel mis à l'abri en cas de faillite, un capital social libre avec un minimum de 1 euro et le choix du régime d'imposition (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), même si à partir de mi-mai 2022 la loi de finances pour 2022 va instaurer la possibilité pour tous les dirigeants d’EI d’opter à leur tour pour les deux régimes d’imposition.
Il est à noter que depuis le 11 décembre 2016, les EURL relevant du régime des sociétés de personnes et ayant un gérant associé unique personne physique peuvent opter pour le régime micro-entreprise (à condition de respecter les seuils de recettes applicables).
Les inconvénients :
Ce statut juridique est plus compliqué à mettre en œuvre que celui de l'EI (plusieurs formalités de création dont la rédaction de statuts, un certain montant à débourser pour la création...). De plus, si le juriste indépendant souhaite s'associer il devra créer une SARL. Le dirigeant est forcément affilié au régime de la Sécurité Sociale des Indépendants.
Conclusion :
Pour les juristes souhaitant mettre en place une société tout en gardant les avantages du régime micro-entreprise, l’EURL est l’option propice. Elle leur permet de créer la société sans s’associer et peut facilement se transformer en SARL.

Créer mon profil
Améliorez votre visibilité en ligne et développez votre clientèle sur Lexcalibur !
Créer mon compteCréer une entreprise unipersonnelle : la SASU
La SASU ou Société par Action Simplifiée unipersonnelle est une SAS composée par un seul associé, personne physique ou morale. Cette forme juridique est la préférée des juristes indépendants puisqu'elle dispose d'une certaine souplesse de fonctionnement.
Les avantages :
Cette forme de société dispose d’une certaine facilité de fonctionnement, et permet au juriste indépendant d'être affilié au régime général de la Sécurité sociale. Il pourra donc bénéficier d'un statut assimilé salarié qui lui apportera les mêmes avantages qu'un salarié (à l'exception de l'assurance chômage). De plus, le juriste indépendant pourra mettre à l'abri son patrimoine personnel puisqu'il ne pourra être tenu responsable que dans la limite de ses apports.
Les inconvénients :
Les formalités de création sont complexes du fait de la rédaction des statuts, le coût de la protection sociale est élevé, le régime de l'imposition sur le revenu peut être choisi durant 5 ans maximum, la procédure de fermeture d'une SASU est relativement lourde et, comme pour l’EURL, il n'a aucune possibilité de s'associer. Enfin cette forme de société n’est pas cumulable avec le régime micro-entreprise.
Conclusion :
Cette forme de société est l’option adéquate pour les juristes ne souhaitant pas s’établir en entreprise individuelle et qui reste intéressés par le statut de salarié. Elle leur permet de créer la société sans s’associer et peut facilement se transformer en SAS.
4 - Quel est le salaire moyen d’un juriste indépendant ?
Le salaire moyen d’un juriste indépendant dépend directement du temps de travail qu’il alloue à son activité, de son nombre de clients et de sa spécialité. En France, il se situe aux alentours de 5500 euros par mois. Les débutants, comme les étudiants ou les jeunes juristes peuvent commencer à toucher un salaire d'environ 915 euros bruts par mois tandis que ceux ayant davantage d'ancienneté peuvent atteindre les 10 230 euros bruts par mois.
Il doit cependant être fait remarquer que de nombreuses charges pèsent sur les professions libérales, et donc sur les juristes indépendants. Elles représentent environ 60% des revenus d’un juriste indépendant.
Chez Lexcalibur, nous garantissons que votre profil soit mis en avant et proposé aux utilisateurs recherchant vos compétences. Nous sommes là pour vous aider dans votre marketing et dans votre recherche de clients : n’hésitez pas à créer un compte chez nous pour débuter ou accroître votre activité !