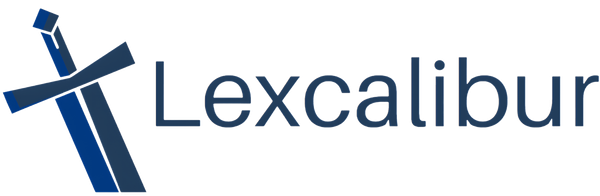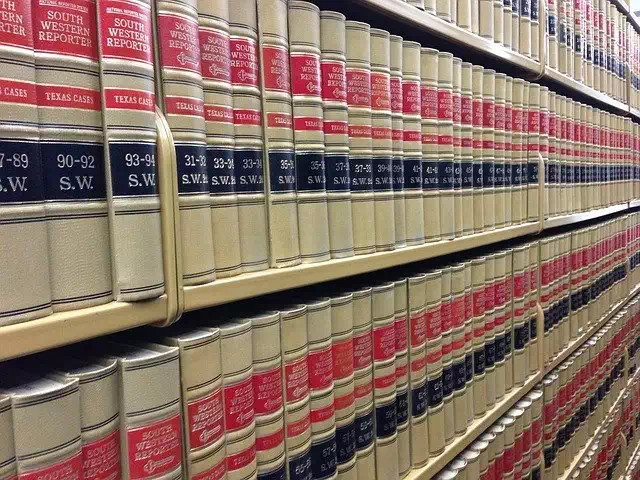L’exclusivité territoriale, souvent qualifiée de « pierre angulaire » dans les contrats de franchise, vise à sécuriser la répartition géographique des franchisés au sein d’un réseau. Elle s’inscrit dans un équilibre complexe : celui qui oppose le libre jeu de la concurrence aux besoins de protection et de stabilité d’un réseau de franchisés. Ce mécanisme permet à chaque franchisé de développer son activité sur une zone délimitée, sans craindre le démarchage actif d’un confrère sur son territoire.
Pourtant, la clause d’exclusivité territoriale soulève de nombreuses difficultés pratiques et juridiques : quels sont ses fondements ? Comment fonctionne-t-elle dans un contexte où les clients peuvent se déplacer ou commander en ligne ? Quelles en sont les limites, notamment vis-à-vis du droit de la concurrence ? Quelles sanctions pèsent sur ceux qui enfreignent cette exclusivité ?
Pour répondre à ces interrogations, cet article propose une analyse approfondie et didactique de l’exclusivité territoriale en franchise. Il s’efforce de mêler les aspects juridiques (Code civil, Code de commerce, réglementations européennes) et les enjeux économiques (rentabilité du réseau, prévention des conflits internes). L’objectif est de dresser un panorama complet de la question, de manière à guider aussi bien les praticiens du droit que les chefs d’entreprise, les franchisés et les futurs candidats à la franchise.
Au fil de ce développement, nous examinerons l’évolution historique de la clause d’exclusivité, ses justifications, sa validité juridique, ses conditions de mise en œuvre, ainsi que les conséquences d’une violation. Nous émaillerons notre propos d’exemples concrets, de références jurisprudentielles et de conseils pratiques destinés aux acteurs de la franchise. Enfin, nous esquisserons quelques perspectives d’avenir, eu égard notamment à l’expansion du commerce en ligne et à la mondialisation des réseaux de franchise.

Partie 1. Origines et évolution historique de l’exclusivité territoriale
1.1. Les premières formes d’exclusivité
L’idée d’exclure un tiers d’un marché ou d’un territoire donné remonte à l’Antiquité, sous la forme de privilèges concédés par les puissances publiques. À travers le temps, le droit commercial a progressivement structuré ces privilèges pour favoriser la croissance économique et la stabilité des échanges. On observe ainsi, dès le Moyen Âge, des chartes et privilèges accordant à certaines corporations un monopole sur une zone urbaine ou un type de production.
Ces formes anciennes de privilèges, bien qu’éloignées des clauses modernes d’exclusivité territoriale, en constituent néanmoins un lointain ancêtre. Les franchises elles-mêmes ont des origines médiévales (avec la notion de « francs tenanciers »), puis se sont transformées, à partir du XXᵉ siècle, en un modèle d’affaires mondialement reconnu, basé sur la transmission d’un savoir-faire et l’exploitation d’une marque.
1.2. Le développement des réseaux de distribution exclusive
Au XXᵉ siècle, l’essor de la grande distribution et des réseaux de concession a contribué à formaliser l’exclusivité territoriale dans les contrats. Les constructeurs automobiles, par exemple, octroyaient à leurs concessionnaires un secteur précis, ce qui leur assurait une certaine sécurité pour investir dans des infrastructures de vente et d’après-vente.
Ces engagements exclusifs ont parfois été jugés contraires aux principes de la libre concurrence, notamment aux États-Unis, où la jurisprudence s’est interrogée sur la licéité des « vertical restraints » (restrictions verticales) que constituent les clauses d’exclusivité.
En Europe, la préoccupation s’est intensifiée avec la création du Marché commun (Traité de Rome, 1957), puis l’accroissement des échanges intra-communautaires. Les règlements de la Commission européenne sur les accords verticaux (par exemple, le Règlement (UE) 330/2010, puis le Règlement (UE) 2022/720) ont encadré la validité de ces restrictions, notamment en distinguant les ventes actives (prohibées hors territoire exclusif) et passives (permises).
1.3. La place de l’exclusivité territoriale dans la franchise
La franchise s’est imposée dans la seconde moitié du XXᵉ siècle comme un modèle de distribution et de prestation de services particulièrement dynamique. En contrepartie de droits d’entrée et de redevances (royalties), le franchisé obtient un savoir-faire, un droit d’utiliser l’enseigne et une assistance technique. Pour encourager la motivation et l’investissement du franchisé, le franchiseur est souvent incité à lui octroyer une zone d’exclusivité, par laquelle il s’engage à ne pas implanter un autre franchisé dans ce secteur, ni à autoriser le démarchage actif par un membre du réseau.
L’enjeu est de taille : la clause d’exclusivité territoriale incite le franchisé à développer l’enseigne localement, tout en évitant la cannibalisation mutuelle entre franchisés. En même temps, il s’agit de s’assurer que cette exclusivité ne conduise pas à une entente anticoncurrentielle.
Dans la pratique, le droit national (Code de commerce, Code civil) et les textes européens relatifs à la concurrence se superposent, imposant un cadre légal précis.
Partie 2. Fondements juridiques et principes de base de l’exclusivité territoriale
2.1. Le socle contractuel
Le contrat de franchise est un contrat synallagmatique : le franchiseur fournit un savoir-faire, des signes distinctifs (marques, logos) et une assistance. En échange, le franchisé verse une redevance et s’engage à respecter les normes de l’enseigne. La clause d’exclusivité territoriale s’inscrit dans ce contrat comme un engagement réciproque. Souvent, elle comporte deux volets :
- Le franchiseur s’engage à ne pas installer un autre franchisé dans le secteur déterminé, ni à exploiter lui-même un point de vente sous la même enseigne dans cette zone.
- Les franchisés s’interdisent de prospecter activement au-delà de leur territoire, ou sur le territoire d’autrui.
2.1.1. Contenu et limites de la clause
La clause doit préciser clairement la délimitation spatiale de l’exclusivité (par exemple, les limites d’un arrondissement, le périmètre d’une ville, ou un rayon de X kilomètres autour du point de vente) et sa durée (souvent calquée sur la durée du contrat de franchise). Il convient également de distinguer les ventes actives (démarchage publicitaire ou commercial ciblé) et les ventes passives (le fait de répondre à une demande spontanée d’un client situé hors de la zone).
Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que la clause d’exclusivité ne doit pas être l’occasion d’entraver de manière injustifiée la libre concurrence. Cela signifie qu’on ne peut pas interdire au franchisé de vendre à un client venant spontanément d’une autre région (vente passive). De même, l’étendue géographique de l’exclusivité doit demeurer proportionnée au marché cible.
2.1.2. Sanctions en cas de violation contractuelle
Si l’exclusivité territoriale est rompue, la partie lésée peut agir devant le tribunal de commerce pour faire valoir ses droits. L’inexécution contractuelle peut conduire à :
- Une action en référé visant à faire cesser la violation,
- Une demande de dommages-intérêts pour réparer le préjudice,
- Une éventuelle résiliation du contrat de franchise si la faute est grave,
- L’activation d’une clause pénale, si le contrat le prévoit et si le juge considère qu’elle est d’un montant proportionné (article 1231‑5 du Code civil).
2.2. Fondement délictuel : l’action en concurrence déloyale
Outre la responsabilité contractuelle, la violation de l’exclusivité peut être analysée comme un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du Code civil (anciennement article 1382). Il faut alors démontrer la présence d’une faute (le fait d’aller démarcher la clientèle située dans le secteur réservé à un autre franchisé), d’un préjudice (baisse de chiffre d’affaires, détournement de clientèle) et d’un lien de causalité entre les deux. Le franchisé victime peut ainsi demander réparation, indépendamment des dispositions contractuelles, s’il parvient à prouver que ces agissements lui ont causé un dommage.
Cette double approche (contractuelle et délictuelle) confère une protection renforcée à la partie lésée. Elle permet également d’invoquer la violation d’un engagement de loyauté au sein du réseau de franchise.
Les tribunaux sont sensibles à l’atteinte portée à l’équilibre général du réseau, qui repose sur la bonne foi et le respect des territoires respectifs.
2.3. Cadre concurrentiel européen
2.3.1. Les règlements sur les accords verticaux
Les contrats de franchise sont qualifiés d’accords verticaux, puisque le franchiseur se trouve en amont (fourniture de services, de savoir-faire) et le franchisé en aval (exploitation au détail ou dans un service local). À ce titre, ils entrent dans le champ d’application des règlements européens encadrant ces accords, notamment le Règlement (UE) 330/2010 (aujourd’hui remplacé par le Règlement (UE) 2022/720, dont l’entrée en vigueur progressive et les périodes transitoires méritent examen).
Ces règlements admettent que la restriction de ventes actives hors territoire demeure légitime, tant que la part de marché du fournisseur et du distributeur ne dépasse pas certains seuils (généralement 30 %).
2.3.2. La distinction ventes actives / passives
La Commission européenne et la jurisprudence communautaire insistent sur cette différence. Les ventes actives sont définies comme « toute démarche proactive visant un public situé dans le territoire exclusif d’un distributeur ». À l’inverse, les ventes passives consistent à répondre aux demandes spontanées de clients. Cette distinction protège la liberté du consommateur, qui peut choisir de se fournir où il le souhaite, tout en permettant une protection minimale du franchisé dans son périmètre.
Partie 3. Les différentes formes de violation de l’exclusivité territoriale
3.1. La mise en place d’un point de vente concurrent
La forme la plus évidente de violation est l’implantation physique d’un nouveau magasin franchisé ou d’une succursale appartenant au franchiseur, dans le secteur réservé à un franchisé existant. Cette pratique entraîne souvent un détournement de clientèle direct. Les juges n’hésitent pas à la qualifier de faute grave, justifiant parfois la résiliation du contrat et l’octroi de dommages-intérêts.
3.1.1. Exemples jurisprudentiels
Cour d’appel de Paris, 3 avril 2012 : le franchiseur avait autorisé l’ouverture d’un second point de vente à quelques centaines de mètres du franchisé initial, lequel disposait d’une clause d’exclusivité couvrant ce périmètre. Les juges ont condamné le franchiseur à indemniser le franchisé lésé pour concurrence déloyale et rupture fautive du contrat.
Cour de cassation, 29 janvier 2008, n° 07-10.611 : dans un réseau de concession, la Haute juridiction a considéré que l’installation d’un nouveau concessionnaire dans la zone exclusive d’un concessionnaire existant constitue un manquement à l’obligation contractuelle, indépendamment du fait que ce nouveau point de vente ciblait ou non la clientèle de l’ancien.
3.2. Le démarchage actif par publicité ou distribution de prospectus
Une deuxième forme de violation, plus subtile, consiste à mener des campagnes publicitaires ciblées dans la zone d’un autre franchisé. Par exemple, le franchisé A distribue des tracts dans les boîtes aux lettres du territoire exclusif du franchisé B, ou diffuse des annonces géolocalisées sur internet visant principalement la clientèle résidant dans cette zone. Le critère essentiel est la volonté de toucher un public bien déterminé : la clientèle locale du franchisé lésé.
3.2.1. Distinction entre publicité générale et ciblée
Si le franchisé A diffuse sa publicité à très large échelle (ex. : une publicité nationale dans un magazine), sans cibler spécifiquement le territoire de B, il est plus difficile de qualifier la démarche de « vente active prohibée ». En revanche, s’il dépose des prospectus dans les boîtes aux lettres du quartier où B est implanté, ou s’il configure ses publicités Google Ads pour n’apparaître qu’aux internautes de cette zone, les juges y verront un acte de prospection ciblée illicite.
3.2.2. Jurisprudence récente
La Cour de cassation a récemment rappelé (décision du 4 décembre 2024, n° 23-17.908) que la simple distribution de prospectus dans la zone d’un autre franchisé constituait un démarchage actif et ciblé, peu important l’absence d’éléments comparatifs ou d’attaques directes contre l’enseigne du franchisé lésé. Cette position confirme la fermeté de la Haute juridiction en la matière.
3.3. Les ventes en ligne et le géoblocage
Avec l’expansion du commerce en ligne, la question de l’exclusivité territoriale se complexifie. Les clients peuvent commander depuis n’importe quel endroit, y compris s’ils se trouvent dans le secteur d’un autre franchisé.
Comment distinguer la vente passive (un client local qui se rend spontanément sur le site) de la vente active (une campagne publicitaire en ligne spécifiquement ciblée sur la zone d’autrui) ?
3.3.1. Vente passive sur internet
Il est généralement admis qu’un franchisé ayant un site e-commerce ne doit pas refuser la vente à un client situé hors de sa zone, car ce serait une restriction dite « de vente passive ». Néanmoins, si ce franchisé met en place des bannières publicitaires géolocalisées pour toucher spécifiquement les internautes d’un territoire exclusif, il sort du champ de la vente passive pour entrer dans la vente active prohibée.
3.3.2. Injonctions et astreintes
En cas d’abus, le franchisé victime peut solliciter du juge des mesures d’interdiction visant la publicité incriminée. Il peut aussi réclamer la mise en place de filtres ou l’arrêt de campagnes de marketing numérique. Le tribunal peut prononcer des astreintes afin de forcer le contrevenant à cesser rapidement ces pratiques.
Partie 4. Les conséquences économiques et juridiques d’une violation
4.1. Sur le plan contractuel
Le franchisé lésé peut invoquer la violation de la clause d’exclusivité pour obtenir réparation. Les contrats de franchise comportent souvent des clauses prévoyant explicitement :
- Une indemnité forfaitaire ou un barème de dommages-intérêts en cas de violation,
- La possibilité de résilier le contrat du contrevenant, voire du franchiseur si c’est lui qui viole l’exclusivité,
- Un mécanisme de médiation ou d’arbitrage, destiné à régler rapidement les différends internes.
4.2. Sur le plan délictuel (concurrence déloyale)
Comme vu précédemment, l’article 1240 du Code civil sert fréquemment de fondement. Les franchisés soutiennent que le contrevenant a commis une faute, générant un trouble anormal dans leur exploitation. Si la preuve du dommage et du lien de causalité est rapportée, le juge condamnera le fautif à verser des dommages-intérêts, voire à cesser toute campagne commerciale litigieuse.
4.3. Sur la cohésion du réseau
Outre les impacts juridiques, la violation de l’exclusivité détériore la confiance au sein du réseau. Les franchisés peuvent estimer que le franchiseur ne joue pas son rôle d’arbitre ou qu’il laisse faire les comportements déloyaux. Ce climat de suspicion risque d’affaiblir l’enseigne globalement, de ternir sa réputation et de compromettre le recrutement de futurs franchisés.
Partie 5. Stratégies préventives et bonnes pratiques
5.1. Délimitation précise de la zone et formation des franchisés
La première précaution consiste à définir clairement le secteur exclusif, en utilisant des indications géographiques sans ambiguïté (liste de communes, codes postaux, etc.). Le contrat de franchise doit également indiquer comment ce périmètre peut évoluer au fil du temps (croissance démographique, fusion de communes, etc.). Par ailleurs, il est conseillé d’organiser des sessions de formation pour que les franchisés mesurent l’importance de la distinction entre ventes passives et actives.
5.2. Mise en place d’une politique de communication validée
Le franchiseur peut exiger des franchisés qu’ils soumettent leurs campagnes publicitaires (physiques ou en ligne) à un service interne de validation. Ainsi, si un franchisé souhaite diffuser des flyers dans une zone limite, le franchiseur pourra vérifier si cela ne mord pas sur le secteur d’autrui. Il en va de même pour les publicités Facebook Ads ou Google Ads, où un ciblage géographique peut être paramétré.
5.3. Médiation et règlement amiable des différends
Avant d’envisager la voie judiciaire, un système de médiation interne au réseau peut être prévu. Un médiateur, choisi d’un commun accord, tentera de concilier les positions. En cas d’accord, cela évite de longs procès et limite les coûts. Le franchiseur peut également jouer un rôle d’arbitre, à condition de rester impartial.
Partie 6. Les grands axes de jurisprudence
6.1. Rappels généraux
La jurisprudence française et européenne rappelle systématiquement que l’exclusivité territoriale est licite si elle n’interdit pas les ventes passives et si elle est nécessaire à la bonne organisation d’un réseau. Les décisions soulignent l’importance de démontrer que le démarchage a un caractère ciblé et qu’il ne s’agit pas d’une simple publicité nationale ou générale.
6.2. Jurisprudence française notable
- Cass. com., 4 décembre 2024, n° 23-17.908 : acte de démarchage ciblé (distribution de prospectus) dans la zone d’un franchisé, retenant la qualification de trouble manifestement illicite justifiant la cessation en référé.
- Cass. com., 29 janvier 2008 : installation d’un deuxième point de vente sur la zone réservée à un concessionnaire, consacrant la responsabilité de l’initiateur de l’opération.
6.3. Jurisprudence européenne
La Commission européenne, dans ses lignes directrices sur les restrictions verticales, valide les clauses interdisant les ventes actives hors d’un territoire exclusif, mais prohibe celles qui empêcheraient un client de passer une commande spontanée.
Les arrêts de la CJUE (ex-CJCE) insistent sur la nécessité de préserver la liberté de choix du consommateur.
Partie 7. Focus : l’exclusivité territoriale face aux nouvelles technologies
7.1. E-commerce et plateformes de mise en relation
Avec la digitalisation du commerce, la frontière entre territoires devient poreuse. Les réseaux de franchise se dotent souvent de boutiques en ligne, de services de livraison et de click-and-collect. Comment assurer la pertinence de l’exclusivité territoriale dans ce contexte ? Si un client localisé dans la zone de tel franchisé commande sur le site d’un autre franchisé, s’agit-il d’une vente active ou passive ?
La plupart des spécialistes considèrent qu’une telle commande relève de la vente passive, sauf preuve d’un ciblage marketing particulier. Ainsi, le franchisé ne peut pas refuser la vente, mais ne peut pas non plus mener activement des campagnes destinées spécifiquement au public d’un autre franchisé.
7.2. Applications mobiles et géolocalisation
Certaines enseignes proposent des applications mobiles indiquant les points de vente les plus proches. Si l’application oriente systématiquement l’utilisateur vers le franchisé hors territoire, alors qu’il se trouve pourtant dans la zone d’un confrère, cela pourrait être interprété comme un manquement à l’exclusivité. Le franchiseur doit paramétrer ces outils pour respecter les limites de chacun, voire renvoyer vers la liste complète des franchisés disponibles dans la zone de l’utilisateur.
7.3. Publicités ciblées sur les réseaux sociaux
Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube permettent de cibler très précisément les utilisateurs selon leurs lieux de résidence ou leur parcours en ligne. Un franchisé pourrait être tenté d’exploiter ces fonctionnalités pour toucher la clientèle potentielle d’un autre secteur.
De nouveau, la question se pose : est-ce une extension légitime ou un démarchage prohibé ? Les tribunaux examineront la configuration de la campagne, le rayon géographique défini, et l’intention de l’annonceur.
Partie 8. Études de cas pratiques
8.1. Étude de cas n°1 : Franchise de restauration rapide
Contexte :
- Trois franchisés installés dans trois arrondissements d’une grande ville.
- Chacun dispose d’une exclusivité pour son arrondissement, sur un rayon de 2 km autour de son restaurant.
Fait générateur :
- Le franchisé A constate que des flyers de son confrère B sont distribués dans ses boîtes aux lettres situées à 1 km de son point de vente. Les flyers proposent une réduction de 30 % sur toute commande.
Analyse :
- L’arrondissement et la zone de 2 km autour du restaurant A sont censés être protégés.
- La distribution de flyers est clairement un acte de vente active. B aurait pu se défendre si ces tracts étaient diffusés à grande échelle dans toute la ville, mais ici, A démontre qu’il s’agit bien de son périmètre.
Conséquences :
- A peut saisir en référé le tribunal de commerce pour faire cesser la diffusion de prospectus.
- Sur le fond, A peut réclamer des dommages-intérêts et la mise en œuvre d’une éventuelle clause pénale si prévue dans leur contrat de franchise.
8.2. Étude de cas n°2 : Vente en ligne pour un réseau de cosmétique
Contexte :
- Une enseigne de cosmétique haut de gamme fonctionne en franchise.
- Chaque franchisé gère un site e-commerce.
- La franchise mentionne une exclusivité territoriale pour les ventes en magasin physique, mais autorise la vente en ligne sans limite, à condition de ne pas faire de publicité ciblée hors de son territoire.
Fait générateur :
- Le franchisé X investit massivement dans la publicité Google Ads paramétrée pour toucher une zone spécifique correspondant à la ville du franchisé Y, où X n’a pas de point de vente physique.
- Y s’aperçoit que les internautes de sa commune voient régulièrement des promotions de X et passent commande sur le site de X.
Analyse :
- Cette configuration illustre un démarchage actif hors territoire. Même s’il n’y a pas de présence physique, la publicité est spécifiquement géolocalisée.
- On sort du cadre de la simple vente passive en ligne, qui autorise la réception de commandes spontanées depuis n’importe quelle localité.
Conséquences :
- Y peut demander l’arrêt immédiat de la campagne Google Ads ciblée sur sa zone.
- S’il subit un préjudice mesurable (chiffre d’affaires en baisse, clients perdus), il peut réclamer une indemnisation.
- X risque des sanctions internes prévues par le contrat (clause de pénalité financière, voire résiliation si la faute est qualifiée de grave).
Références : https://www.lebouardavocats.com/blog-posts/violation-exclusivite-territoriale-franchise
LE BOUARD AVOCATS
4 place Hoche,
78000, Versailles
https://www.lebouard-avocats.fr/
https://www.avocats-lebouard.fr/
https://www.lebouardavocats.com/