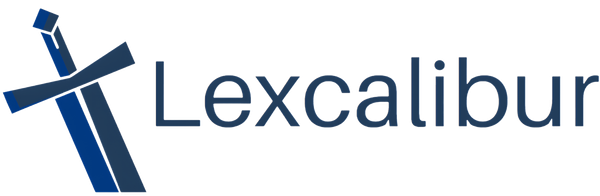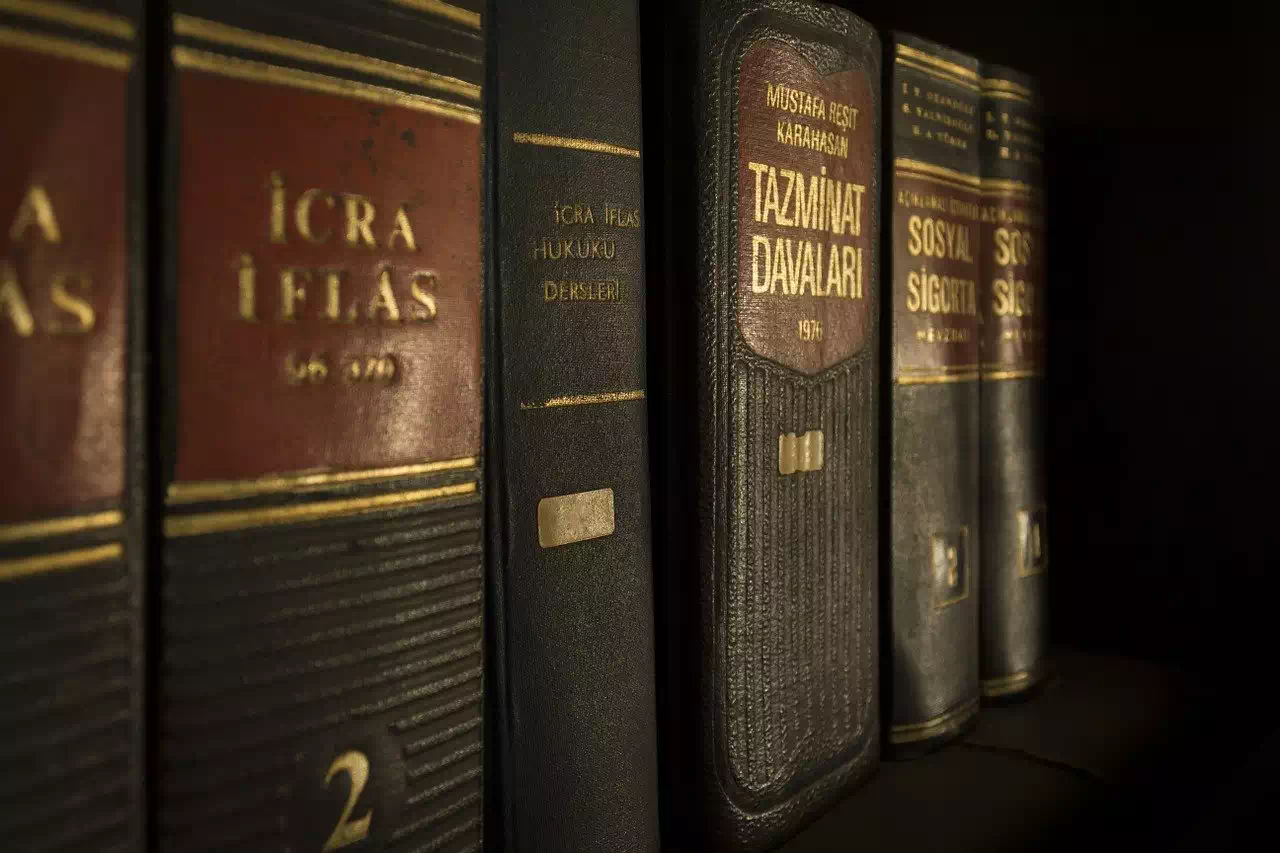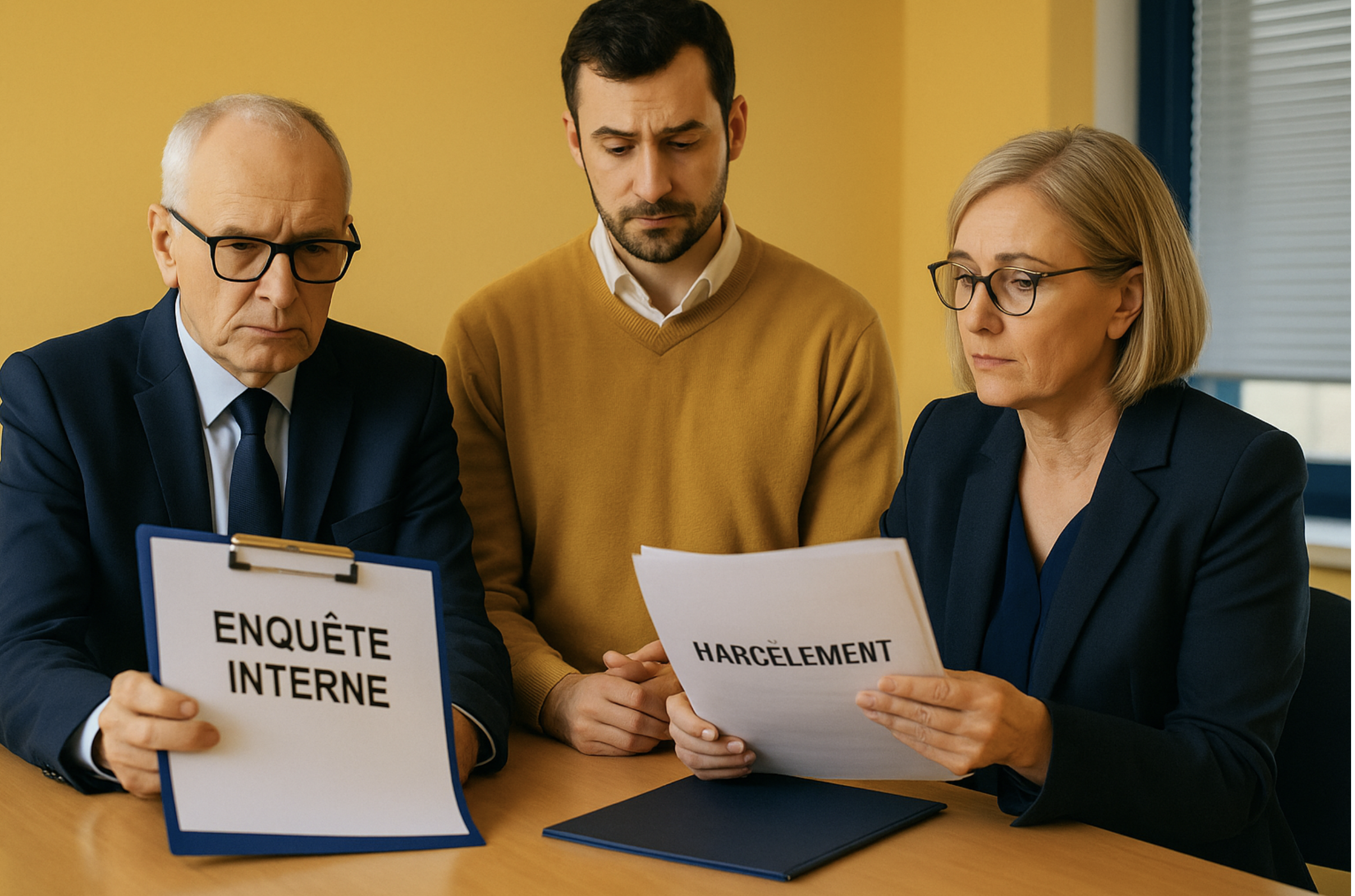Dans un contexte de mobilité professionnelle croissante, les salariés amenés à se déplacer loin de leur domicile dans le cadre de missions temporaires doivent pouvoir compter sur une prise en charge équitable de leurs frais. À l’inverse, les employeurs ont besoin d’un cadre clair pour indemniser sans risquer un redressement URSSAF. C’est précisément sur ce point que l’arrêt rendu le 10 avril 2025 par la Cour de cassation (n° 23-10.593) apporte une clarification précieuse.
Il réaffirme un principe fondamental : ce n’est pas le mode de versement de l’indemnité qui compte, mais le fait que le salarié supporte réellement la charge des frais liés au déplacement. Cette décision, favorable à une approche pragmatique, impose néanmoins une rigueur particulière dans l’analyse des situations de déplacement.
Elle rappelle que les indemnités de grand déplacement ne peuvent être versées (et exonérées) que si elles reposent sur des frais réels, spécifiques à la mission, et supportés par le salarié.

1 - Ce que dit le droit : encadrement juridique des indemnités de grand déplacement
Le versement d’indemnités de grand déplacement est encadré par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels. Il s’agit de sommes destinées à compenser les dépenses de repas et de logement supportées par le salarié lorsqu’il ne peut regagner chaque jour sa résidence habituelle en raison d’un déplacement professionnel.
Les conditions d’éligibilité
Deux critères cumulatifs doivent impérativement être réunis :
- Le salarié se trouve dans une situation de grand éloignement, rendant impossible un retour quotidien au domicile (critère de distance et/ou de durée de trajet, souvent plus de 50 km ou 90 minutes aller).
- Le salarié engage des frais supplémentaires directement liés à cette situation (hébergement, repas…).
Lorsque ces conditions sont respectées, l’employeur peut verser :
- Des indemnités forfaitaires, dans la limite de plafonds réglementaires (ex. : 48 € par nuitée en métropole pour l’hébergement en 2025),
- Ou des remboursements au réel, sur justificatifs.
Dans les deux cas, et uniquement dans ces conditions, ces indemnités sont exclues de l’assiette des cotisations sociales.
L’enseignement de l’arrêt du 10 avril 2025
Dans l’affaire tranchée, l’entreprise avait logé ses salariés via des baux signés en direct avec les bailleurs. Le coût du logement était ensuite retenu sur les bulletins de paie des salariés, tandis qu’une indemnité forfaitaire leur était versée. L’URSSAF a estimé que les salariés n’avaient pas supporté de frais (puisque l’entreprise avait réglé les loyers), et a procédé à un redressement. La Cour de cassation a invalidé cette position, affirmant que :
Il importe peu que la dépense ait été avancée par l’employeur, dès lors qu’elle est effectivement supportée par le salarié.
Autrement dit, ce qui compte, c’est la charge réelle et non le circuit financier. Ce raisonnement protège à la fois :
- Le salarié, qui conserve son droit à indemnisation, même si l’entreprise organise le logement à sa place,
- L’employeur, qui peut sécuriser son exonération s’il démontre que la charge a bien été transférée au salarié (ex. : par une retenue, un remboursement, ou toute preuve de dépense).
La Cour reconnaît également que les frais engagés par le salarié ne se limitent pas au loyer : frais d’entretien, de double logement, de téléphonie ou d’équipement, tous sont considérés comme spécifiques à la mission.
2 - Ce que cela implique concrètement : sécuriser la pratique et faire valoir ses droits
Cette décision impose un devoir de rigueur aux deux parties. Pour éviter les contentieux et sécuriser les pratiques, salariés comme employeurs doivent comprendre ce que recouvre réellement la notion de grand déplacement.
Pour les employeurs : obligations de preuve et bonnes pratiques
L’exonération n’est pas automatique. L’employeur doit pouvoir démontrer :
- La réalité de la mission à distance (ordre de mission, adresse, durée, éloignement),
- La charge effective supportée par le salarié (retrait sur salaire, frais annexes…),
- Le respect des plafonds réglementaires.
La documentation est essentielle : baux, bulletins de paie, attestations, tableaux de suivi. En cas de contrôle, l’URSSAF vérifie la finalité de l’indemnité. Si l’employeur ne prouve pas que l’indemnité correspond à des frais engagés par le salarié, elle peut être requalifiée en salaire déguisé, déclenchant redressement, intérêts de retard et pénalités.
Pour les salariés : vigilance sur les retenues et les indemnisations
Si vous êtes salarié en mission loin de votre domicile :
- Vous avez droit à une indemnisation juste pour vos frais de repas et de logement,
- Si votre entreprise avance les frais mais vous les retire ensuite de votre salaire, vous devez recevoir une indemnité équivalente,
- Vos frais ne se limitent pas au loyer : tout coût spécifique à votre éloignement doit être pris en compte.
Si vous constatez une absence d’indemnisation, ou une retenue injustifiée, vous pouvez :
- Demander une régularisation amiable,
- Solliciter les représentants du personnel ou l’inspection du travail,
- Saisir le conseil de prud’hommes en dernier recours.
L’indemnité de grand déplacement est un outil essentiel pour garantir l’équilibre entre mobilité professionnelle et respect des droits du salarié. L’arrêt du 10 avril 2025 rappelle que l’approche doit être fondée sur la réalité économique : ce qui compte, ce n’est pas qui paie, mais qui supporte le coût. Un principe simple, mais qui suppose une mise en œuvre rigoureuse et transparente, au bénéfice des deux parties.
LE BOUARD AVOCATS
4 place Hoche, 78000, Versailles
https://www.lebouard-avocats.fr/