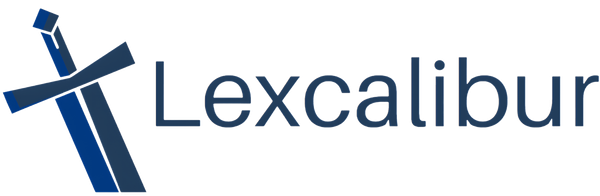L’allusion au titre emblématique du roman de science-fiction de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques (publié en 1968), ne relève plus uniquement du domaine de l’imaginaire. Avec l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA), des questions juridiques inédites émergent, notamment en matière de propriété intellectuelle.

1 - Les contenus générés par l’IA et le droit d’auteur
Les contenus générés par l’IA sont-ils par exemple éligibles à la protection par le droit d’auteur (qu’il s’agisse de contenus musicaux, littéraires, graphiques, etc.) ?
Ces contenus sont-ils librement exploitables par les tiers ? Pour rappel, selon la conception du droit français, afin qu’une œuvre soit qualifiée d’œuvre de l’esprit et éligible à la protection par le droit d’auteur, elle doit correspondre à une création intellectuelle « originale ».
Si une personne morale peut évidemment être titulaire de droits d’auteur sur une telle œuvre (suite par exemple à une cession de droits), seule une personne physique peut être l’auteur d’une œuvre de l’esprit. Le droit français retient en effet un lien personnel et humain entre le créateur et son œuvre.
2 - L’absence de lien humain : un obstacle à la protection
Or, les contenus générés par l’IA, s’ils peuvent être originaux, sont dépourvus de tel lien avec un créateur personne physique, ce qui exclurait donc leur protection par le droit d’auteur. En revanche, si de tels contenus générés par l’IA reprennent de façon substantielle d’autres œuvres originales créées, elles, par des personnes physiques, l’exploitation de ces contenus peut s’avérer contrefaisante et susceptible de poursuites judiciaires.
3 - Recommandations aux entreprises exploitant l’IA
Ainsi, je recommande fréquemment à mes clients (notamment les sociétés éditant ou exploitant de tels procédés) de s’assurer de l’absence de contrefaçon des contenus générés par leurs procédés exploitant l’IA. En outre, s’il est considéré que les œuvres générées par l’IA ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur, cela signifie que les sociétés exploitant de tels procédés ne peuvent revendiquer de droits de propriété intellectuelle à leur sujet.
4 - Concurrence déloyale : une alternative juridique
La sanction d’une utilisation non autorisée de ces contenus pourrait toutefois être recherchée et obtenue sur le terrain de la concurrence déloyale. Par conséquent, je recommande également à mes clients d’être particulièrement scrupuleux sur la rédaction de leurs mentions légales. En effet, les mentions légales leur permettent de déterminer le périmètre dans lequel ils acceptent ou non l’utilisation de leurs contenus générés par l’IA.
5 - Perspectives d’évolution juridique
Il est évident que le statut juridique de l’IA reste à affiner et donnera lieu à de nombreux débats et évolutions qui devront être tranchés par le législateur et les tribunaux. Des projets sont notamment en cours à l’échelon de l’Union européenne.
Des perspectives européennes
À l’échelle de l’Union européenne, des projets sont en cours pour harmoniser et adapter les règles de propriété intellectuelle à l’ère de l’IA. Ces évolutions, encore à l’état embryonnaire, pourraient redéfinir les contours de la protection des contenus générés par des machines, offrant ainsi un cadre plus stable aux acteurs du secteur.