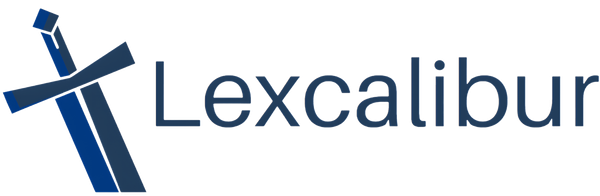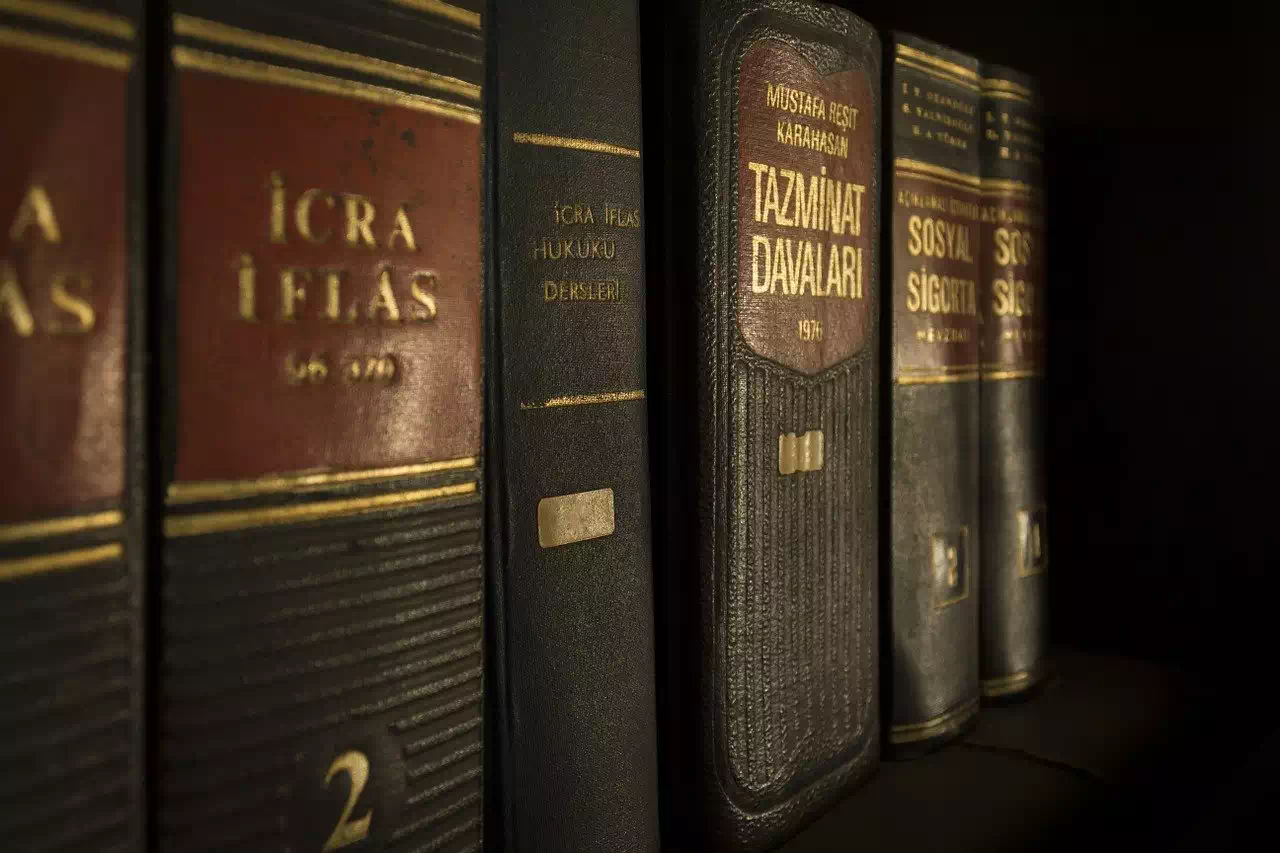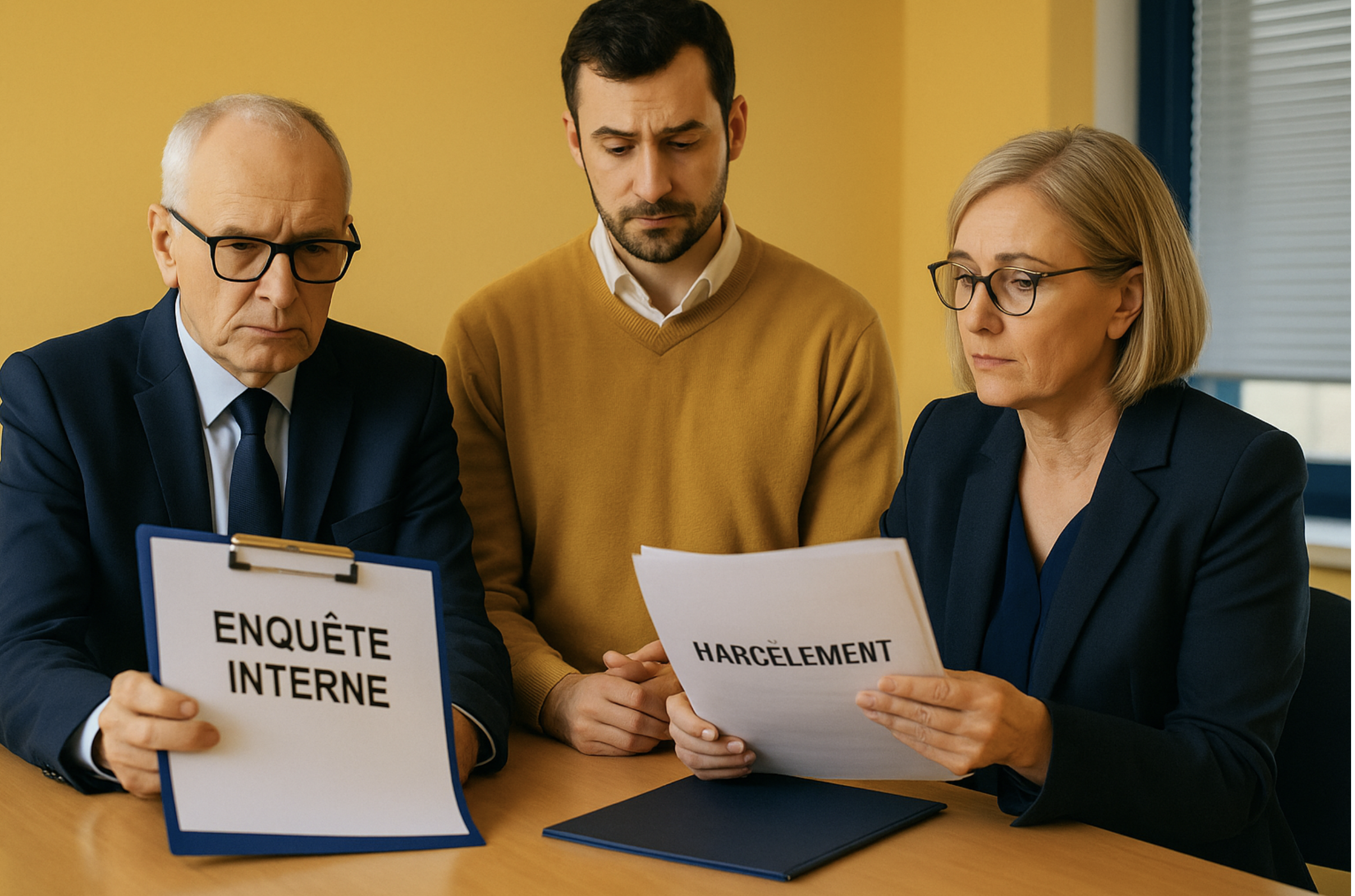- Vous avez renversé votre café sur l'ordinateur de l'entreprise. Vous avez perdu votre badge, multiplié les contraventions, détérioré votre véhicule de fonction?
- Vous vous êtes fait.e voler la recette?
- Vous avez un trou de caisse?
Je n'ai pas dressé la liste de toutes les bêtises possibles pouvant être commise lors de l'exécution du contrat de travail et pourtant, ayant personnellement mis hors service toute la batterie de la cuisine d'un restaurant en jetant de l'eau dessus (pour la nettoyer), les possibilités en la matière sont infinies. En psychologie, cela peut s'apparenter à un acte manqué. En droit, la question est la suivante:
Vais-je devoir payer pour ma bêtise? En termes plus nobles, l'employeur a t-il le droit de retenir une partie du salaire dont il estime qu'elle lui est due ? La réponse tient en deux lignes (et demies). Aucune retenue sur salaire n'est admise, que ce soit sur le salaire, les primes ou les avantages en nature (Cour de cassation, 23 juin 2010, 09-40.825, Inédit), sauf en cas de volonté de nuire du salarié ou, dans certains cas, lorsque ce dernier devait de l'argent à son employeur. En effet, l'employeur n'est ni juge, ni policier, comme le précise le Code du travail.
Le fait d'infliger une amende ou une sanction pécuniaire (....) est puni d'une amende de 3 750 euros. Article L1334-1 du Code du travail

Vous pouvez consulter le site le monde merveilleux du travail pour en savoir plus sur le fonctionnement et calcul de la retenue sur salaire.
1 - La dette du salarié autorise la retenue sur salaire : la compensation
Je te dois, tu me dois: Le mécanisme de la compensation est exprimé par l'Article 1347 du Code civil (toujours très clair dans son genre). Cette formulation m'a longtemps agacée et signifie tout simplement que si on vous doit 30 euros mais que vous en devez 50, vous n'en devrez plus que 20. En droit, cela signifie qu'en vertu de ce mécanisme, l'employeur peut procéder à une retenue de salaire s'il s'avère que vous lui deviez plus qu'il vous a versé en vertu de votre contrat de travail.
La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Article 1347 du Code civil
2 - Trop-perçus récupérables par l'employeur
Peuvent ainsi être récupéré par l'employeur:
- Les trop-perçus de salaire
- Les trop-perçus de maintien de salaire
- Les avances
Un acompte n'est pas une avance. Un acompte est un du de l'employeur et correspond à la situation où le salarié réclame une somme pour le mois + 1. Si le salarié n'est plus dans l'entreprise, l'employeur n'aura d'autre choix que d'intenter une action aux prud'hommes, ce qui signifie simplement que c'est le juge qui demandera au salarié de rembourser. C'est assez rare (question de dignité). Mais même dans cette hypothèse, l'employeur ne peut pas procéder à une retenue de salaire pour compenser n'importe quelle dette:
La dette doit avoir un rapport avec le contrat de travail
Ainsi, si ces dettes n'ont pas de rapport avec le contrat de travail, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une retenue sur salaire. Une banque bien connue avait ainsi eu l'ingénieuse idée d'effectuer une retenue sur le salaire d'un salarié, qui avait eu également l'ingénieuse idée d'avoir pour banque son employeur. Le salarié était à découvert et l'employeur a procédé au recouvrement.... sur le bulletin de salaire. Non: La Cour de cassation a nettement rappelé que la convention de banque est une chose, le contrat de travail en est une autre. Dans certains secteurs, l'employeur a, par ailleurs, l'interdiction pénale (Article R 3255-1 du Code du travail) de ne pas se servir du mécanisme de la compensation et ce, même si le salarié lui doit effectivement de l'argent au titre de son contrat de travail. Ces secteurs, précisés à l'Article L3251-4 du Code du travail sont les suivants:
- Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ;
- Entreprises de spectacle, cercles et casinos ;
- Entreprises de transport.
La dette ne doit pas être due "pour fourniture"
Si vous devez une somme d'argent en lien avec une "fourniture", l'employeur ne peut vous effectuer une retenue sur salaire. C'est très vague et très large: En principe, l'Article L3251-1 est (pour une fois) clair : "L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature", sauf pour les suivantes (Article L3251-2 du Code du travail):
- 1° Outils et instruments nécessaires au travail ;
- 2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
- 3° Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Mais, même pour ces fournitures là, la Cour de cassation, dans son arrêt du 20 avril 2005 n°03-40.069 a précisé que "la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à compensation". Ainsi et concrètement, en cas de contravention avec le véhicule de l'entreprise, le salarié ne pourra se voir infliger une retenue sur salaire au titre de l'article L3251-1 du Code du travail, tandis qu'un salarié qui se fait voler ou perd du matériel ne pourra être prélevé qu'en vertu de la jurisprudence (c'est à dire en cas de faute lourde).

Dans l'hypothèse d'une contravention, l'employeur a l'obligation de demander à son salarié le remboursement. Si ce dernier refuse (ambiance assurée), l'employeur devra le désigner conducteur.
3 - Faute lourde et la responsabilité du salarié
Même en cas de faute lourde, l'employeur doit saisir le juge pour mettre en cause la responsabilité pécuniaire du salarié. Faute lourde : volonté de nuire du salarié, et suppose licenciement et procédure judicaire de l'employeur contre le salarié. Autant vous le dire tout de suite, si vous l'employeur invoque une faute lourde, c'est que vous y êtes allés franco. La liste des exemples des fautes lourdes est cocasse et me régale toujours outrageusement: Il a été considéré qu'avoir une "love affair" avec son employeur (en l'occurrence "employeuse"), se faire éconduire (ça arrive), être toujours en poste, puis s'auto-frapper avant de déposer plainte pour violences avec armes contre son employeuse (qui dorénavant reverra peut-être ses critères) constituait une faute lourde (CA Rouen, ch. soc., 31 janv. 2012, n° 11/02782).
Autre: Dire à un client que les marchandises qu'il achète sont volées (alors que non, pas du tout) et l'inciter à porter plainte (CA Agen, 7 oct. 2014, n° 13/01420. Bon, vous voyez le genre. Et bien dans ce cas, non seulement l'employeur doit prouver la faute lourde, la charge de la preuve lui incombant totalemen (Cour de cassation 5 mai 1960, n° 451 Publié au bulletin) ce qui implique qu'il prouve les sombres intentions de son salarié à son égard, ce qui est difficile sauf si le salarié s'est vanté de ses intentions, MAIS EN PLUS, même si il y parvient, il sera tenu d'aller en justice afin que le juge condamne le salarié à indemniser l'employeur (Article 1240 du Code civil). En d'autres termes, l'employeur ayant subi un préjudice intentionnellement causé par son salarié, ne peut, de lui même, effectuer une retenue sur son salaire (mais sur ses indemnités de licenciement, cela restera possible, car ceux-ci n'ont pas une nature de salaire).
Une femme de ménage m'avait un jour confié avoir brûlé la chemise qu'elle repassait et qui appartenait à quelqu'un dont elle estimait qu'il la déconsidérait. Son acte était réellement non intentionnel. Elle n'avait réellement pas fait exprès (acte manqué). Mais en aurait t-il été autrement, l'employeur n'aurait pas été en mesure de le prouver, ni de lui retenir une partie de son salaire correspondant au montant de la chemise.
La Cour de cassation rappelle parfois qu'à l'égard de son employeur, la responsabilité pécuniaire d'un salarié ne peut résulter que de sa faute lourde Cour de cassation, 25 janvier 2017, Pourvoi n° 14-26.071
4 - Le cas du salarié sanctionné
Lorsque qu'un salarié est sanctionné (mise à pied disciplinaire ou conservatoire), son contrat de travail est suspendu. Son salaire ne lui est donc pas versé. Cela ne constitue pas une retenue sur salaire. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de recours. Simplement, la "retenue sur salaire" est impropre à caractériser la situation.

5 - Montant pouvant être retenu par l'employeur en cas de faute lourde
L'employeur ne peut pas retenir plus d'une certaine somme. Cette somme supérieure dépend du salaire net (après prélèvement à la source) et du nombre de personnes que vous avez à votre charge: Accès direct au simulateur Pour ceux qui aiment tout comprendre, voici comment est calculé le montant retenu: Sur le salaire, une partie seulement est saisissable (la "quotité"): Contrairement à ce que son nom laisse à penser, cela ne signifie pas que la retenue sur votre rémunération correspond à cette partie.
Cela signifie que l'employeur peut retenir une partie de cette partie (une partie de cette "quotité"). Exemple : Si vous gagnez 1000 euros net, la quotité saisissable est de 115 Euros (qui correspond à 1/20 d'un seuil fixé à l'avance). L'employeur peut donc retenir une partie de cette quotité, soit 17 Euros. Si vous avez une ou plusieurs personnes à charge, la quotité est moins importante. Si vous devez une pension alimentaire, elle est plus importante. Article R 3252-2 du Code du travail : La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
- 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 170 €uros
- 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 170 €uros et inférieure ou égale à 8 140 €uro
- 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 140 €uros et inférieure ou égale à 12 130 €uros
- 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 130 €uros et inférieure ou égale à 16 080 €uros
- 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 080 €uros et inférieure ou égale à 20 050 €uros
- 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 050 €uros et inférieure ou égale à 24 090 €uros
- 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 24 090 €uros.
Le Décret n° 2022-1648 du 23 décembre 2022 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations précise les seuils applicables.