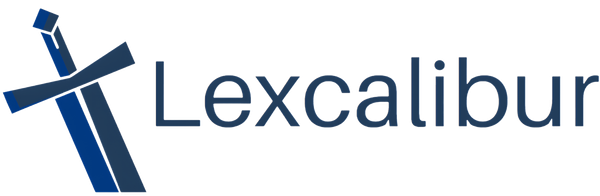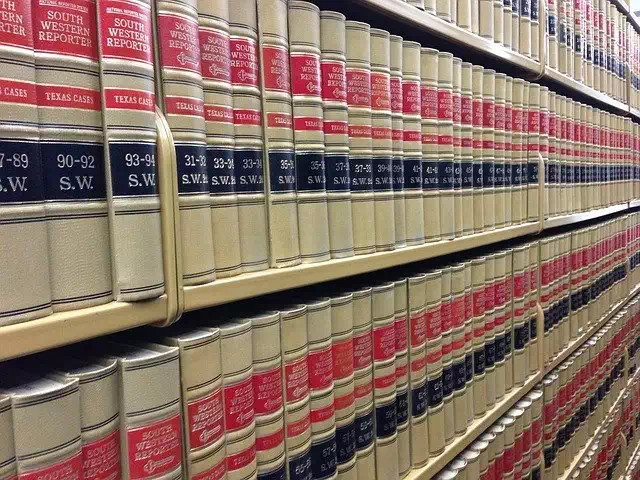Le plan de cession d’entreprise représente une solution judiciaire clé pour sauver une activité viable lorsqu’une société se trouve en difficulté. Prévu par les articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, il permet à un repreneur de racheter les actifs d’une société placée en redressement ou liquidation judiciaire, tout en préservant les emplois et en contribuant à l’apurement du passif.
Mais ce dispositif, souvent perçu comme une seconde chance, reste rigoureusement encadré. Il ne transfère pas automatiquement les dettes et n’a pas d’effet libératoire pour les cautions. Retour sur les principes, les effets et les précautions indispensables à toute reprise dans le cadre d’un plan de cession.
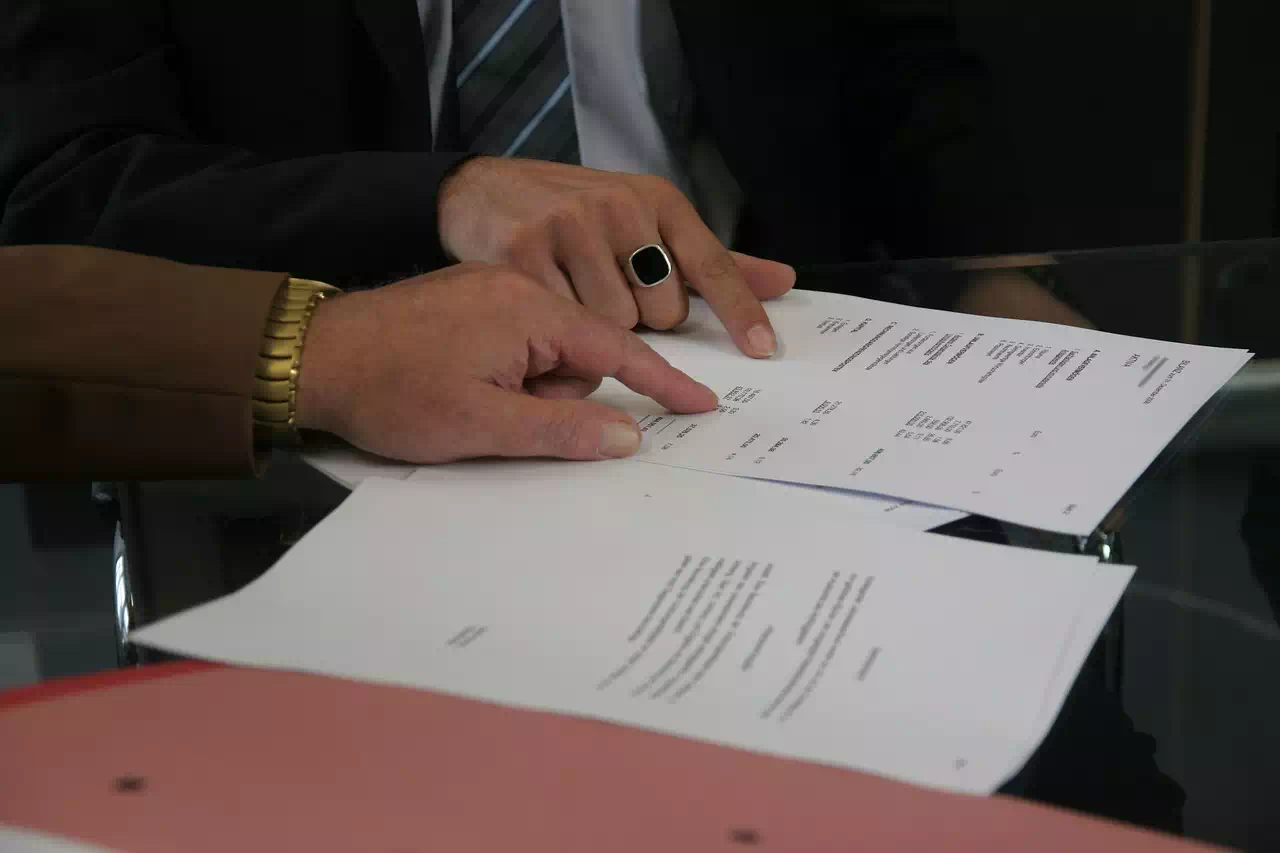
1 - Le plan de cession : une solution judiciaire au service de la continuité économique
A - Définition et objectifs du plan de cession
Le plan de cession d’entreprise consiste à transférer à un repreneur tout ou partie des actifs, droits et contrats nécessaires à la poursuite de l’activité d’une société en difficulté.
L’article L. 642-1 du Code de commerce fixe sa triple finalité :
- assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome,
- sauvegarder tout ou partie des emplois,
- et contribuer à l’apurement du passif.
Le plan de cession n’a donc pas pour but de sauver la société en elle-même, mais de préserver son activité. Il s’agit d’une cession judiciaire d’actifs opérée dans le cadre d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire).
Ce mécanisme intervient lorsque la société débitrice ne peut être redressée, mais dispose encore d’un potentiel économique exploitable. Le repreneur devient le nouveau chef d’entreprise, tandis que la société cédée poursuit son existence dans le cadre de la procédure.
B - Une procédure encadrée par le tribunal de commerce
Le plan de cession est soumis à une procédure transparente et contradictoire, sous la supervision du tribunal de commerce et des organes de la procédure (administrateur judiciaire, mandataire judiciaire).
Les étapes principales sont les suivantes :
- Appel à repreneurs publié par le mandataire, précisant les conditions et délais de dépôt des offres ;
- Dépôt des offres de reprise, accompagnées d’un plan industriel, social et financier ;
- Analyse des offres par les organes de la procédure et transmission au ministère public ;
- Audience d’examen et jugement arrêtant le plan, après audition des parties ;
- Transfert des actifs au repreneur, conformément au jugement.
Le plan peut être total (l’ensemble de l’entreprise est cédé) ou partiel (certaines branches ou établissements).
C - Un dispositif d’intérêt général
Le plan de cession ne bénéficie pas seulement au repreneur : il vise également la préservation de l’emploi et le maintien du tissu économique local.
Le tribunal sélectionne l’offre la plus équilibrée, tenant compte :
- du prix proposé,
- du sérieux du projet industriel,
- du nombre d’emplois repris,
- et des garanties financières apportées.
En pratique, le plan de cession est un outil de redressement économique à forte dimension sociale, au croisement du droit des affaires et du droit du travail.
2 - Les effets juridiques du plan de cession : un transfert limité et encadré
A - Le périmètre du transfert : actifs et contrats
Selon l’article L. 642-7 du Code de commerce, le jugement arrêtant le plan détermine précisément les biens, droits et contrats transférés.
Les actifs corporels (immeubles, matériel, stocks) et incorporels (marques, clientèle, droit au bail) peuvent être inclus.
Le tribunal peut également autoriser la cession de certains contrats nécessaires à la poursuite de l’activité, même sans accord du cocontractant :
- les contrats de travail, transférés de plein droit conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
- les baux commerciaux ;
- les contrats d’approvisionnement essentiels.
Toutefois, les contrats non nécessaires ou déjà exécutés (comme les prêts bancaires) ne sont pas transférés.
B - L’exclusion des prêts et dettes antérieures
La Cour de cassation, dans son arrêt du 2 juillet 2025 (n° 24-13.481), a rappelé avec force que le prêt bancaire conclu avant la procédure collective n’est pas un contrat en cours et ne peut donc être inclus dans le plan.
L’engagement du repreneur à rembourser les échéances ne vaut pas novation par substitution de débiteur au sens de l’article 1329 du Code civil (ancien article 1271).
En conséquence :
- le débiteur initial reste tenu du prêt,
- la caution personnelle demeure engagée,
- et la banque conserve ses droits sur les sûretés.
Cette solution protège la sécurité juridique du crédit et rappelle que le plan de cession ne modifie pas la nature des dettes ni le régime des garanties antérieures.
C - Le maintien des sûretés et cautions
Les sûretés réelles et personnelles attachées aux dettes antérieures demeurent valables tant que la créance principale n’est pas éteinte.
Le plan de cession n’a pas d’effet libératoire sur les cautions, sauf accord exprès du créancier.
Cette précision est essentielle pour les dirigeants qui se sont portés garants de leur société. Beaucoup pensent être libérés par la cession, alors qu’ils restent juridiquement responsables du remboursement des prêts non repris.
Le principe est clair : la novation ne se présume jamais. Seule la signature d’un accord tripartite entre le créancier, le débiteur et le repreneur peut opérer une substitution de débiteur et libérer la caution.
3 - Les précautions à prendre pour sécuriser un plan de cession
A - Pour le repreneur : maîtriser le périmètre de la reprise
Le repreneur doit identifier avec précision le périmètre juridique et économique de la cession.
Le jugement arrêtant le plan constitue la seule référence opposable : ce qui n’y figure pas n’est pas transféré.
Avant toute offre, il est impératif de :
- analyser les actifs repris et leur valeur réelle ;
- vérifier les contrats en cours et leurs conditions de transfert ;
- examiner les dettes non reprises pour éviter toute confusion postérieure.
Un audit juridique et financier approfondi est indispensable. Le repreneur doit également anticiper la trésorerie nécessaire à la relance et négocier les relations futures avec les créanciers.
B - Pour le dirigeant cédant : anticiper les conséquences de ses engagements
Le chef d’entreprise cédé doit être particulièrement attentif à ses engagements de caution.
Même après la cession, il reste tenu des dettes garanties si la banque n’a pas expressément accepté de le libérer.
Pour éviter toute poursuite ultérieure, il doit :
- demander la mainlevée de ses cautions avant la cession,
- négocier une substitution de garantie avec le repreneur,
- obtenir un accord écrit du créancier.
Une vigilance particulière doit également être portée sur la rédaction du jugement : certaines imprécisions peuvent maintenir artificiellement la responsabilité du cédant.
C - Pour les créanciers : préserver leurs droits
Le plan de cession ne modifie pas les droits des créanciers.
Ceux dont la créance n’est pas reprise restent titulaires de leurs sûretés sur le débiteur initial et peuvent agir contre la caution.
Pour eux, le plan représente une garantie de continuité de remboursement sur le long terme, mais ils doivent veiller à :
- déclarer leurs créances dans les délais légaux,
- contester le plan si leurs droits sont affectés,
- négocier directement avec le repreneur en cas de volonté de transfert du prêt.
4 - Un instrument de relance exigeant une parfaite maîtrise juridique
Le plan de cession d’entreprise est une procédure exceptionnelle qui allie enjeux économiques, sociaux et juridiques.
S’il permet de sauver des activités viables et de préserver des emplois, il demeure un dispositif techniquement exigeant.
L’arrêt du 2 juillet 2025 illustre parfaitement la rigueur du régime :
- le plan n’opère pas transfert des dettes non expressément reprises,
- il ne libère pas les cautions,
- et il impose une lecture stricte du jugement d’arrêté.
Pour les dirigeants et repreneurs, la réussite d’un plan de cession repose sur trois piliers :
- l’anticipation juridique,
- la clarté contractuelle,
- et l’accompagnement par un avocat expérimenté.
Le plan de cession n’est pas une simple transaction commerciale : c’est un acte judiciaire structurant, où chaque clause compte. Bien préparé, il devient un véritable levier de relance et un outil stratégique de transmission d’entreprise.